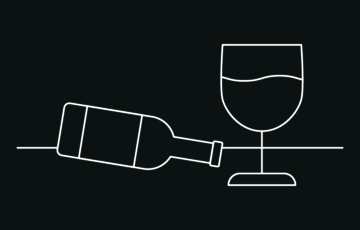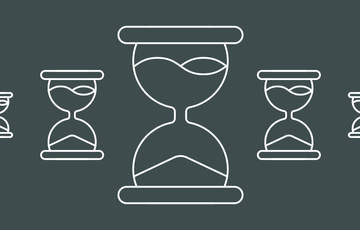L’alcoolo-dépendance touche toutes les classes d’âges, mais les seniors sont particulièrement exposés. Après 75 ans, près de 37% des hommes et 15% des femmes consomment quotidiennement des boissons alcoolisées, soit entre trois et cinq fois plus que chez les personnes actives de moins de 65 ans. En Suisse, 6,2% des seniors souffrent d’une consommation problématique d’alcool, soit l’équivalent de plus de quatre verres de vin par jour pour un homme et deux pour une femme, selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la santé publique. Et environ un tiers des individus concernés ont développé cette addiction après l’âge de la retraite.
En parallèle, cette population consomme aussi de nombreux médicaments, notamment les benzodiazépines, des calmants qui comprennent les Temesta et Xanax, pris par près de 18% des plus de 75 ans, d’après un rapport d’Addiction Suisse.
Risque accru de troubles psychologiques
«La sortie de la vie active, le deuil d’un-e proche ou encore le manque de contacts sociaux exposent certaines personnes à des troubles psychiques, comme la dépression et l’anxiété», explique Pierre Vandel, médecin-chef au Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) du CHUV.
Bien qu’elle soit fréquente, cette détresse psychologique est souvent mal diagnostiquée chez les personnes de plus de 65 ans. «Les symptômes les plus courants, comme le sentiment de profonde tristesse, la diminution des facultés psychomotrices ou encore la perte d’appétit, sont parfois considérés à tort comme un simple effet du vieillissement. Cette banalisation entraîne malheureusement beaucoup de retards dans l’accès aux soins chez des personnes qui en auraient pourtant besoin.»
En plus, les comportements à risque passent facilement sous les radars, surtout chez les personnes qui vivent seules. «La consommation excessive d’alcool, par exemple, n’est souvent repérée qu’après avoir eu ses premiers effets néfastes sur la santé: par exemple lors d’une hospitalisation pour un état confusionnel aigu ou un accident sur la voie publique.»